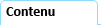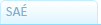Veuillez noter que ce texte est déjà paru dans le volume 2 des Cahiers du CIRADE On a pu croire pendant un instant que les tentatives inlassablement répétées des tenants du néolibéralisme en vue de démanteler l'État au profit d'un marché globalisé et géré par les capitaines de la finance internationale, avaient atteint leur but. L'incorporation de la citoyenneté étant chose faite ou en voie de l'être1, la société civile s'était bel et bien transformée en associations soumises et dociles de consommateurs et de consommatrices (Bauman, 1999) prêts à acheter tous les types de biens que l'on peut fabriquer, dont les produits culturels et les savoirs. De plus, le citoyen ou la citoyenne2 ne pensait alors qu'à réaliser son propre profit et à faire valoir ses droits individuels. Toutefois, des événements récents indiquent que ce que d'aucuns qualifient de marchandisation et d'autres de McDonalisation du monde (Barber, 2000) n'a pas été véritablement achevé. Les forces de l'opposition se sont regroupées pour faire échec à une certaine idée économiste de la mondialisation. En effet, le démantèlement de l'Accord multilatéral sur l'investissement (AMI)3 et l'échec retentissant de la dernière réunion de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en décembre 1999 à Seattle témoignent que de nouvelles solidarités internationales se sont nouées afin de constituer un contre-pouvoir qui réclame l'établissement d'une société plus juste, plus égalitaire, soucieuse du respect des droits individuels et collectifs pour tous les citoyens et toutes les citoyennes de la planète. Certes, si on peut voir dans ces événements l'acte de naissance d'une société civile internationale comme le souligne Ramonet (2000), il importe de ne pas s'emballer outre mesure4 et, sans cynisme, de mesurer le chemin à parcourir. En contrepartie, il paraît raisonnable de penser que ces événements, de même que ceux qui se déroulent plus près de nous, telle l'action menée par la coalition des citoyens et citoyennes de Val St-François qui s'opposent à la construction de la ligne de 735 KV planifiée par Hydro-Québec5 , constituent une lueur d'espoir au regard du développement d'une forme de démocratie participative. Bon nombre de citoyens et de citoyennes ont secoué le joug exercé sur eux par le sentiment d'impuissance qui les avait gagnés au cours des dernières décennies et s'engagent sans retenue dans des discussions et des débats autour d'une variété de problèmes sociaux et environnementaux. En somme, la création d'un contrat social mondial et l'émergence d'une nouvelle citoyenneté apparaissent désormais comme un autre possible ou, à tout le moins, une utopie régulatrice susceptible d'orienter le design de nos futurs, selon l'expression du collectif The New London Group (1996), et ce, tant dans la sphère communautaire et dans la sphère publique que dans la sphère du travail. Le succès de cette contre-offensive suppose qu'un certain nombre d'obstacles soient démantelés ou que, selon l'expression de Petrella (1997), des nœuds soient déliés. Ce dernier soutient qu'il faudra délégitimer la rhétorique dominante qui conduit à réifier les concepts de globalisation, de compétition, de marché (Bourdieu & Wacquant, 2000) et à leur conférer un caractère essentialiste, voire naturel, comme l'illustrent parfaitement les propos de Minc (1997) sur le capitalisme : « le marché n'est pas un état de culture de la société, le choix d'un système parmi d'autres ; c'est un état de nature » (p. 11). Sur un autre plan, Petrella estime qu'il sera tout aussi fondamental de rétablir le dialogue des cultures afin de contrer tous les intégrismes à l'Ouest comme à l'Est. Enfin, il considère que le marché financier devra être désarmé et qu'il faudra transformer le rôle des technosciences dans nos sociétés en les soustrayant à l'influence mercantile des groupes financiers et des entreprises. Les propos de Petrella esquissent les grandes opérations d'un vaste chantier pour l'avenir plutôt qu'un plan d'action réalisable à court terme, mais ils fournissent tout de même les éléments de la problématique générale qui donne relief et sens à la position qui sous-tend le présent essai. Je me limiterai toutefois à présenter, dans un premier temps, quelques réflexions à propos des technosciences contemporaines afin d'indiquer comment elles sont performatives du social (Callon, 1999) et doivent alors être envisagées en tant que problèmes sociaux, comme le rappelle Restivo (1988) : « modern science is implicated in the personal trouble and public issues of our time » (p. 209). Les débats publics autour des enjeux de divers ordres (éthiques, politiques, économiques, etc.) liés au domaine de la biotechnologie, dont ceux qui gravitent autour de la question de la diffusion des OGM (organismes génétiquement modifiés), en témoignent de manière éloquente. Dans un deuxième temps, je tenterai d'illustrer brièvement comment la participation des citoyens et des citoyennes à ces divers débats est intimement liée au type de rapport aux savoirs technoscientifiques qu'ils ont généralement développé dans le contexte de l'éducation scolaire aux sciences, rapport qui ne les prépare guère à s'engager de plain-pied dans les controverses socioéthiques liées à la production et aux usages de ces savoirs dans nos sociétés. Ce n'est pas d'hier que les dimensions sociopolitiques des technosciences sont prises en considération par des philosophes et des sociologues qui s'intéressent à la production des savoirs technoscientifiques. Il n'était pas bien difficile, par exemple, de saisir que la fabrication de la première bombe atomique dans le cadre du projet Manhattan puis son largage sur Hiroshima ne pouvaient êtres dissociés de l'univers social et politique de l'époque (Sassower, 1997). Sur un autre plan, nombre d'études ont montré qu'au cours du siècle dernier, en particulier à l'occasion des deux grandes guerres, les technosciences ont été intégrées au complexe militaro-industriel en Occident, l'expression « Big Science » (Price, 1963) ayant en partie été inventée pour désigner un tel processus qui s'accompagnait d'ailleurs d'une croissance exponentielle du nombre de scientifiques. De la même façon, si on en croit les discours publics, on considère de nos jours que les technosciences constituent le fer de lance de la « nouvelle économie » dans une société du savoir. Par exemple, à l'occasion de la publication d'un mémoire sur la science et la technologie dans la réforme du curriculum de l'enseignement primaire et secondaire, le Conseil des Sciences et de la Technologie du Québec (CSTQ), qui joue un rôle important dans l'orientation de la politique scientifique au Québec, formule ce type de discours à propos des technosciences : La science et la technologie sont les moteurs de l'innovation et se situent donc au cœur du développement économique des sociétés contemporaines. Ce qui caractérise la société du savoir et l'économie de l'innovation c'est précisément la prééminence du rôle que jouent désormais les connaissances scientifiques et l'innovation technologique dans l'environnement social, culturel, économique et politique. (1998, p. 3) On ne peut être plus clair. Les technosciences seraient associées étroitement aux aspects culturels, économiques et politiques de la vie en société. Mais comment doit-on envisager cette association ? Est-il encore pertinent, à l'instar du CSTQ, de penser la socialité des technosciences comme si celles-là n'avaient que des effets sociaux et n'étaient pas elles-mêmes des productions sociales ? La question me semble importante dans la mesure où la représentation que l'on se fait de la socialité des technosciences est déterminante dans la construction de notre rapport à ces savoirs et à ceux et celles qui les détiennent, c'est-à-dire les experts et les expertes scientifiques. Mais que nous apprennent les travaux contemporains à propos de la socialité des sciences ? Les travaux en philosophie, en histoire, en sociologie et en anthropologie des sciences des trente dernières années (Biagioli, 1999 ; Pickering, 1992) ont contribué à l'élucidation du caractère idéologique de ce que Bimber et Guston (1995) nomment l'exceptionnalisme épistémologique des sciences. En effet, il a longtemps été tacitement admis par ceux et celles qui conduisent des travaux en épistémologie des sciences qu'il existait un noyau dur, c'est-à-dire les savoirs scientifiques, qui ne pouvaient être étudiés en tant que tels par des sociologues ou des anthropologues. Seuls les scientifiques de la discipline concernée avaient la crédibilité nécessaire pour tenir un discours pertinent sur la production et la nature de ces savoirs. Les sociologues pouvaient certes étudier l'organisation et le fonctionnement des technosciences comme ceux des autres institutions sociales (financement, système de promotion, collèges invisibles, normes cognitives et éthiques, etc.), mais il leur était interdit de se prononcer sur la valeur du contenu scientifique dont on prétendait qu'il transcendait les contingences sociales de sa production. Autrement dit, par un processus plus ou moins ésotérique que l'on peut comparer au mystère de l'Immaculée conception (Fuller, 1997), le savoir scientifique produit en société était débarrassé de ses scories idéologiques ou métaphysiques et acquérait ainsi des propriétés quasi divines (objectivité, universalité, transcendance, etc.). Bien plus, en particulier dans les milieux scolaires, on prétendait que ceux et celles qui pratiquaient la forme d'ascétisme méthodologique requis pour faire des sciences développaient, à la longue, une personnalité reflétant ces mêmes propriétés. Ces scientifiques adeptes de la désincarnation se transformaient en êtres neutres, capables de faire fi de leur subjectivité et de porter un regard détaché sur les choses. Or, à l'encontre de ces thèses, il a pu être montré que les technosciences sont en quelque sorte sociales de part en part, en amont comme en aval, du processus de production des savoirs. A closely related genre of recent studies has emphasized understanding the evidentiary context, the socially negociated conventions and criteria for coming to local agreement about the outcome of experiments, about the technical and performative conditions for replicating experiment, agreement about what constitutes competent performance and about the standard of trust and evaluation. (p. 70) Par ailleurs, chacune des expériences réalisées en laboratoire convoque de proche en proche de grands pans du vaste réseau des technosciences. Ainsi, les scientifiques doivent faire confiance aux fournisseurs de produits ou d'animaux standardisés, à leurs collègues de diverses disciplines qui jugent de la valeur des savoirs sur lesquels ils et elles s'appuient, aux fabricants d'instruments, de même qu'aux théories dont ces instruments sont la matérialisation. En ce sens, ces savoirs sont donc marqués par les contingences de divers ordres (matérielles, symboliques, économiques, sociales, etc.) constitutives des conditions locales de leur production. Dès lors, leur caractère soi-disant universel, qui suppose que les scientifiques adoptent une position surplombante par rapport à un objet d'étude6 , relève de la fiction, voire d'une mystification, tout comme la mise en œuvre d'une méthode particulière de travail, LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE, afin de résoudre les problèmes qu'ils et elles ont conçus et mis en forme. De fait, leurs pratiques théoriques et empiriques diversifiées et enchevêtrées ressemblent davantage à un bricolage intellectuel et matériel collectif qu'à une activité cérébrale générée par un esprit désincarné, situé hors du monde, qui, en solitaire, pense une théorie ou conçoit une expérimentation. Mais comment expliquer que ces produits circonstanciels et contingents, publiés sous la forme d'énoncés qui font référence à leurs conditions de production (Si ... a,b,c, ... Alors... x,y,z), acquièrent une certaine robustesse et une acceptabilité régionale voire, dans certain cas, internationale ? Les savoirs sont toujours produits localement, et leur transport dépend du transport des dispositifs matériels, humains, techniques auxquels ils sont attachés. La généralité du savoir se construit pas à pas par déplacement, chaque déplacement enrichissant et transformant les savoirs eux-mêmes. On duplique les laboratoires et non pas les énoncés. (p. 73) L'une des leçons que l'on peut tirer des travaux que je viens rapidement d'évoquer c'est que, d'une part, les technosciences produisent des savoirs relatifs puisqu'ils sont tributaires de leurs conditions locales de production et que, d'autre part, elles constituent de véritables pratiques sociales. Il n'est donc plus possible, comme le soutient pourtant le CSTQ, de réduire la socialité des technosciences à leurs effets sociaux, comme si elles n'étaient pas elles-mêmes des pratiques sociales. Bien plus, il est dorénavant nécessaire de saisir que le social se fabrique au sein même des laboratoires dans la mesure où l'on y produit des entités, des êtres qui peuvent entrer dans la composition de notre monde commun, et ainsi reconfigurer les relations sociales. Les cas rapidement évoqués dans le paragraphe qui suit sont autant d'illustrations de ce que Callon (1999) nomme la performation du social. Dans un ouvrage publié à l'occasion du centième anniversaire de la mort de Pasteur, Latour (1994) a fort bien montré comment ce savant, en isolant des microbes puis en contrôlant pour ainsi dire leur conduite tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du laboratoire, a reconfiguré les relations sociales au sein de la société française. Il suffit pour s'en convaincre de prendre en considération les conseils que l'on a commencé à donner à cette époque aux écoliers et à leurs parents à la suite des travaux de Pasteur, et ce, entre autres, pour éloigner la menace de propagation des maladies liée à la présence désormais avérée des microbes : toujours se laver les mains avant de manger, dormir la fenêtre ouverte, mettre la main devant la bouche lorsqu'on éternue, ne pas cracher par terre, etc. De plus, pour tenir compte de ces nouveaux arrivants9 dans la collectivité, il a été nécessaire de transformer les pratiques médicales, de créer des lois et des institutions pour encadrer la nouvelle politique de la santé. La société française a été radicalement transformée par la présence des microbes dont Pasteur et ses collaborateurs se sont faits les porte-parole ou les représentants. On pourrait plus ou moins refaire le même genre de scénario et voir comment des entités telles les radiations (centrales nucléaires, conservation des aliments), les virus (SIDA et autres maladies), les gènes (thérapies géniques, clonage, etc.), l'ADN (empreintes génétiques) et les cartes de guichet automatique, pour ne mentionner que celles-là, contribuent à la recomposition de notre monde. Envisagées sous cet angle, les technosciences constituent bel et bien des pratiques sociopolitiques qui participent à la construction de notre monde commun. Or, le maintien du caractère démocratique de nos sociétés suppose que le plus grand nombre possible de citoyens et de citoyennes participent à ce processus d'autant plus que les enjeux sociotechniques qui traversent ce monde commun se présentent de plus en plus sous la forme de la controverse et de l'incertitude fondamentale qui marque les savoirs en cause, comme l'ont tour à tour souligné Irwin (1995) et Wynne (1996). On peut penser que, après coup, Pasteur devait savoir que c'est en recréant dans le milieu les conditions qui prévalent dans le laboratoire qu'il pouvait raisonnablement s'attendre à ce que les microbes se conduisent de manière disciplinée. Certes, il existait des possibilités de dérapage mais, quoi qu'il en soit, au moins sur le plan de la rhétorique, les scientifiques de cette époque prétendaient que des contrôles serrés en laboratoire permettaient de minimiser les risques de divers ordres lors des essais dans le milieu. C'est d'ailleurs pour ces mêmes raisons que, en 1975, des scientifiques américains ont signé le protocole d'Asilomar sur le confinement des expériences portant sur la recombinaison de l'ADN. Mais depuis ce Woodstock de la biologie moléculaire, selon l'expression de Barinaga (2000), les positions ont bien changé si on en croit certains scientifiques, dont le biologiste français bien connu Jacques Testart. À son avis, les essais plein champ réalisés avec des plantes transgéniques ne peuvent permettre un contrôle rigoureux de l'évolution de la situation sur le terrain. Ainsi, les betteraves transgéniques, capables de résister aux herbicides, ont déjà vu passer leur gène de résistance à des mauvaises herbes environnantes ; ainsi, le colza transgénique résistant à l'herbicide Basta s'est montré capable de répandre son pollen jusqu'à plusieurs kilomètres - alors que les experts lui accordaient 500 mètres - et de féconder des variétés sauvages en générant des hybrides fertiles - dont les experts affirmaient pourtant la stérilité... Autre risque : qu'on sélectionne des parasites résistants aux insecticides en utilisant des plantes transgéniques produisant des toxines de bactéries capables de tuer des insectes. Des planteurs en ont fait la douloureuse expérience en investissant dans un coton transgénique qui ne résista pas aux parasites aussi bien que promis, mais induisit une telle résistance chez les insectes qu'il devint nécessaire de distribuer des pesticides en abondance. Les experts avouent que l'évaluation n'est possible que dans les conditions réelles et focalisent l'essentiel de leurs discours sur les procédures de « biovigilance » sans qu'il soit certain que ces procédures suffisent à contenir le risque encouru. (1998, p. 15) La situation à laquelle Testart fait référence indique qu'il y a eu un changement important dans la manière de produire des savoirs scientifiques puisqu'il serait même nécessaire de court-circuiter l'étape des tests de laboratoire ce qui, on en conviendra, fait courir des risques à la population sans que celle-là ait été consultée. Mais peut-on dire qu'il s'agit là d'une position alarmiste ? Il ne semble pas, si on se fie aux propos de Jean-Pierre Berlan, directeur de recherche à l'INRA (Institut National de Recherche Agronomique, France), et de Richard Lewontin, professeur de génétique des populations à l'université Harvard, qui estiment que les conséquences pour l'environnement et la santé des populations de la diffusion de plantes modifiées génétiquement sont totalement inconnues à ce jour (Berlan & Lewontin, 1998). C'est d'ailleurs en référence à ce type d'expérience que Beck (1992, 1997) soutient que nous vivons dans une société du risque manufacturé puisque qu'elle est devenue le laboratoire dans lequel les scientifiques conduisent des essais plus ou moins contrôlés dont les effets peuvent éventuellement affecter l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Tout le monde est exposé, presque sans protection, aux hasards de l'industrialisation (vache folle, radiations nucléaires, contaminations diverses, etc.). Les hasards sont les passagers clandestins de la vie normale du consommateur. Ils voyagent sous le vent et dans l'eau, ils sont dissimulés partout et dans chacun et chacune, et ils sont transmis avec les nécessités de la vie : air, nourriture, habillement, au travers toutes les zones de protection de la modernité. (1997, p. 21) On doit reconnaître que, pour un bon nombre de scientifiques, voire pour une majorité d'entre eux, les propos de Testart, Berlan, Lewontin et Beck seraient carrément alarmistes et qu'il n'y aurait pas lieu de s'inquiéter outre mesure. En fait, comme le souligne Adam (2000), pour ceux et celles qui font la promotion de la production de plantes transgéniques, celles-là comporteraient plutôt de nets avantages par rapport aux plantes indigènes. Il serait éventuellement possible de produire davantage de plantes comestibles, plus nutritives, ayant meilleur goût, et dont la croissance exigerait moins d'engrais, d'herbicides et de pesticides. On pourrait même accroître la biodiversité et favoriser le développement durable. En somme, s'agissant des OGM, tout comme de la xénotransplantation (Weiss, 1997) et du génie génétique (Atlan, 1999), nous avons affaire à des objets controversés au sein même des communautés scientifiques. Leur production, de même que leur diffusion, constituent d'ailleurs des enjeux sociopolitiques et économiques majeurs, comme l'indique la dernière conférence internationale sur la biodiversité ayant réuni, sous les auspices des Nations Unies, des représentants de 130 pays en janvier 2000 à Montréal. Au terme de discussions musclées, un compromis a été atteint et le protocole de biosécurité qui a été signé stipule que les pays exportateurs devront étiqueter les produits qui contiennent des OGM. Par ailleurs, un pays n'aura pas besoin de prouver qu'un produit contenant des OGM est dangereux pour exercer son droit d'en interdire l'importation. On comprend alors un peu mieux les propos de Restivo (1988) cités plus haut relativement aux enjeux des technosciences dans la sphère tant personnelle que publique. De plus, ce qui est totalement nouveau dans ces situations, c'est que les controverses qui s'articulent autour de ces entités nouvelles (prions, couche d'ozone, réchauffement du climat, OGM, etc.) avec lesquelles nous avons à composer ne peuvent en aucune manière se résoudre en catimini, entre scientifiques. En fait, comme le souligne Wynne (1996), c'est l'indétermination fondamentale des savoirs scientifiques qui est ici en cause. En produisant des objets hybrides avec lesquels nous devons (ou non) composer, mais dont les contours et les ramifications sont mal définis, les technosciences ajoutent « leurs propres incertitudes » (Latour, 1997, p. 97) dans les discussions et jettent en quelque sorte de l'huile sur le feu plutôt que de calmer les esprits.
Il n'est pas inutile en certaines occasions de proposer une définition formelle d'un concept ne serait-ce que pour fournir une indication quant à la signification qui lui est attribuée. Ainsi, Charlot, Bautier et Rochex (1992) estiment que l'on doit saisir le concept de rapport au savoir comme: « une relation de sens, et donc de valeur, entre un individu (ou un groupe) et les processus et produits du savoir » (p. 29), et, pourrait-on ajouter, une relation à ceux et celles qui les produisent et les détiennent de même qu'aux institutions dans le cadre desquelles ce savoir est fabriqué. Dès lors, comme le souligne Rochex (1995), ce concept renvoie à un ensemble complexe d'appréciations (valeur attribuée au savoir, statut accordé à ceux et celles qui les détiennent, etc.) qui amènent tout un chacun, consciemment ou non, à prendre position en fonction de sa compréhension des différents enjeux qui se présentent aux acteurs et aux actrices sociaux. Et c'est cette relation construite au fil des expériences sociales, notamment scolaires, qui amène les personnes à se sentir plus ou moins aptes à participer à la définition des problématiques sociotechniques ou encore plus moins capables de dialoguer d'égal à égal avec les experts et les expertes. Mais voyons, à travers un exemple, comment le concept de rapport au savoir joue dans la manière dont on peut décoder une situation courante, dans ce cas, un événement scientifique qui fait la manchette11 . J'utiliserai à cette fin la technique de réécriture des textes mise au point par Fourez (1985), afin de contraster leurs orientations idéologiques ou épistémologiques. En fait, il s'agit simplement de réécrire un premier texte en s'inspirant d'une autre position, ce qui permet en quelque sorte de « voir » que nous sommes bien en présence de points de vue différents sans que l'on ait nécessairement (Mathy, 1997) à suivre pas à pas les détails très fins d'une analyse de discours.
Il est assez aisé de noter que les journalistes de ce scénario virtuel produisent des discours qui traduisent des rapports aux savoirs technoscientifiques forts différents. Le journaliste A semble fasciné par le discours publié dans la revue Nature alors que le journaliste B semble avoir développé un quant à soi, un regard critique, à propos de ce que l'on y raconte. Le journaliste A, comme plusieurs journalistes scientifiques, décrit les « exploits » des scientifiques comme si ces derniers et ces dernières avaient un accès privilégié au réel dont ils ne feraient qu'une description fidèle. Ainsi, les gènes seraient des choses concrètes localisées sur des chromosomes un peu comme des framboises dans un framboisier. Il serait possible d'en produire une image détaillée (ACGT) comme il est possible de le faire pour une framboise en la dessinant ou en la photographiant. Son collègue, le journaliste B, adopte une stratégie discursive fort différente indiquant qu'il adopte une autre position sur le plan épistémologique. D'emblée, il fait référence à la théorie standardisée, celle autour de laquelle un consensus s'est établi au sein de la communauté scientifique et en fonction de laquelle on oriente la recherche, plutôt que de laisser entrevoir que l'activité scientifique consiste simplement à décoder la réalité ontologique. De plus, il spécifie que ce que l'on nomme gène dans ce contexte est un modèle moléculaire et non pas une chose que l'on décrit comme le laissait entendre son collègue. Ainsi, dans un premier mouvement, le journaliste A situe l'activité scientifique dans un monde de choses données à voir, et duquel les sujets seront éventuellement évacués, alors que son collègue situe cette même activité dans un monde de sujets qui produisent des objets de savoir (théories, modèles, etc.) afin de répondre à leurs questions de recherche. Autrement dit, le discours du journaliste A ferme la porte à toute discussion possible sur la nature même des entités nommées gènes et chromosomes dont les seuls porte-parole légitimes seraient les scientifiques. À l'opposé, le discours de son collègue recèle une telle possibilité de discussion car, par définition, modèles et théories peuvent être questionnés et leur portée appréciée. On conviendra que, la plupart du temps, le type de discours véhiculé dans nos médias correspond davantage à celui formulé par le journaliste A qui pourrait difficilement engager une discussion avec des experts et des expertes scientifiques compte tenu de la position qu'il adopte à l'égard de leurs savoirs. La relation qu'il a construite plus ou moins tacitement à l'égard de ces derniers ne peut guère constituer une source d'émancipation, car il est difficile de questionner le statut des savoirs qui disent le VRAI et de contester le discours de ceux et celles qui en sont les porte-parole officiels. Mais comment expliquer la genèse de cette forme d'anesthésie épistémologique (Darré, 1999) qui conduit beaucoup de personnes à nier la valeur de leur propre position, à la considérer comme un simple point de vue dans leurs relations aux experts et aux expertes ? Yet when we examine research at the cutting edge of science, we can « see » a knowledge which is quite different from that enshrined in the school curriculum. It involves debates and struggles about what is to be studied and how. Further, the conception of knowledge used by research scientists privileges strategies to make the familiar strange, to think about the mysterious and the unfamiliar, and to raise questions precisely about that which is taken for granted. The rules of curriculum are quite different as they privilege the stable, fixed and categorical properties of knowledge, even in recent « constructivist pedagogies ». [...] The alchemy that makes the world and events seem to be things of logic removes any social mooring from knowledge. The debate and struggle that produced disciplinary knowledge are glossed over, and a stable system of ideas is presented to children. (p. 97). Ces savoirs, coupés des procès sociaux qui les produisent, ne pourront faire l'objet d'une mise en question de la part des élèves. Ces derniers finiront d'ailleurs par se persuader que leurs savoirs d'expérience, ceux qu'ils ont élaborés dans leur milieu socioculturel d'origine afin de donner un sens aux événements, aux phénomènes constitutifs de leur univers et d'agir ainsi efficacement en contexte, n'ont pas vraiment de valeur ou encore, beaucoup moins de valeur que les savoirs enseignés à l'école. D'ailleurs, celle-là distingue très tôt les grosses et les petites matières contribuant ainsi à la re-production de la hiérarchie sociale arbitraire des savoirs (Messer-Davidov, Shumway, & Sylvan, 1993) et au maintien de la distribution inégale du pouvoir dans nos sociétés. Dès lors, l'engagement du plus grand nombre de citoyens et de citoyennes dans les débats sociotechniques liés à la production et aux usages des savoirs scientifiques suppose que l'on repense la question des savoirs technoscientifiques à l'école et, en particulier, la conception du rapport au savoir dont on souhaite faire la promotion. ADAM, B. (2000). « The temporal gaze : The challenge for social theory in the context of GM food », British Journal of Sociology, vol. 51, nº 1, p. 125-142. ATLAN, H. (1999). La fin du « tout génétique »? Vers de nouveaux paradigmes en biologie, Paris, Éditions INRA. BARBER, B.B. (2000). « Vers une société universelle de consommateurs. Culture McWorld contre démocratie », In M. ELBAZ & D. HELLY (dir.), Mondialisation, citoyenneté et multiculturalisme, Québec et Paris, Presses de l'Université Laval et L'Harmattan, p.211-221. BARINAGA, M. (2000). « Asilomar, vingt-cinq ans après », La Recherche, nº 332, juin, p. 82-84. BARTHE, Y. & RÉMY, É. (1997). « Comment organiser la « concertation » avec les citoyens dans les controverses techniques publiques ? Deux études de cas : le débat sur l'implantation de lignes à haute tension et la gestion de déchets radioactifs à vie longue », In A. GIORDAN, J.-L. MARTINAND & RAICHVARG, D. (dir.), Actes des XIXièmes Journées Internationales sur la communication, l'éducation et la culture scientifiques et industrielles : sciences, technologies et citoyenneté, Paris, Association DIRES, p. 75-82. BAUMAN, Z. (1999). Le coût humain de la mondialisation, Paris, Hachette. BECK, U. (1997). « Global risk politics », In M. JACOBS (Ed.), Greening the millennium, Oxford, Blackwell Publishers, p. 18-33. BECK, U. (1992). Risk society, London, Sage Publications. BERLAN, J-P. & LEWONTIN, R. (1998). « La menace du complexe génético-industriel : racket sur le vivant », Le Monde Diplomatique, nº 537, décembre, p. 1 et 22-23.v BIAGIOLI, M. (Ed.) (1999). The science studies reader, London, Routledge. BIMBER, B. & GUSTON, D.H. (1995). « Politics by the same means : Goverment and Science in the United States », In S. JASANOFF, G.E. MARKLE, J.C. PETERSEN & T. PINCH (Eds), Handbook of science and technology studies, Thousand Oaks, CA, Sage, p. 554-571. BOURDIEU, P. & WACQUANT, L. (2000). « La nouvelle vulgate planétaire », Le Monde Diplomatique, nº 554, mai, p. 6-7. BOURQUE, G. , DUCHASTEL, J. & PINEAULT, É. (1999). « L'incorporation de la citoyenneté », Sociologie et Sociétés, vol. 31, nº 2, p. 41-64. CALLON, M. (1999). « Ni intellectuel engagé, ni intellectuel dégagé : la double stratégie de l'attachement et du détachement », Sociologie du Travail, nº 41, p. 65-78. CAPITAN, C. (2000). « Propriété privée et individu-sujet-de-droits : la genèse historique de la notion de citoyenneté », L'Homme, nº 153, janvier/mars, p. 63-74. CHARLOT, B. (1997). Du rapport au savoir, Paris, Éditions Anthropos. CHARLOT, B., BAUTIER, E. & ROCHEX, J.-Y. (1992). École et savoir dans les banlieues... et ailleurs, Paris, Armand Colin. Conseil des Sciences et de la Technologie du Québec. (1998). La science et la technologie à l'école, Québec, Gouvernement du Québec. DARRÉ, J-P. (1999). La production de connaissance pour l'action, Paris, Éditons de la Maison des sciences de l'homme. FOUCAULT, M. (1971). L'ordre du discours, Paris, Gallimard FOUREZ, G. (1985). Pour une éthique de l'enseignement des sciences, Bruxelles, Vie ouvrière. FOUREZ, G., ENGLEBERT-LECOMPTE, V. & MATHY, P. (1997). Nos savoirs sur nos savoirs : Un lexique d'épistémologie pour l'enseignement, Bruxelles, De Boeck Université. FULLER, S. (1997). Science, Minneapolis, University of Minnesota Press. IRWIN, A. (1995). Citizen Science, London and New York, Routledge LAROCHELLE M., DÉSAUTELS J. & RUEL, F. (1995). « Les sciences à l'école : portrait d'une fiction », Recherches Sociographiques, vol. 36, nº 3, p. 527-555. LATOUR, B. (1994). Pasteur : une science, un style, un siècle, Paris, Perrin & Institut Pasteur. LATOUR, B. (1997). « Crise des valeurs ? Non, crise des faits », In Éthique et environnement, Actes de colloque, Paris, La Documentation Française, p. 95-104. LATOUR, B. (1999). « Les politiques de la nature », Comment faire entrer les sciences en démocratie, Paris, La Découverte. LENOIR, T. (1993). « The discipline of nature and the nature of disciplines », In E. MESSER-DAVIDOV, D.R. SHUMWAY & D.J. SYLVAN (Eds), Knowledges : Historical and critical studies in disciplinarity, Charlottesville, VA, University Press of Virginia, p. 70-102. MATHY, P. (1997). Donner du sens aux cours de sciences. Des outils pour la formation éthique et épistémologique des enseignants, Bruxelles, De Boeck. MESSER-DAVIDOV, E., SHUMWAY D.R., & SYLVAN, D.J. (1993). Knowledges : Historical studies and critical studies in disciplinarity, Charlottesville, VA, University Press of Virginia. MINC, A. (1997). La mondialisation heureuse, Paris, Plon. PETRELLA, R. (1997). Le bien commun, Bruxelles, Éd. Labor. PICKERING, A. (Ed.) (1992). Science as practice and culture, Chicago, The University of Chicago Press. PINCH, T. (1990). « The sociology of the scientific community », In R.C. OLBY, G.N. CANTOR, J.R.R. CHRISTIE & M.J.S. HODGE (Eds), Companion to the history of modern science, London, Routledge, p. 87-99. PINEAULT, É. (1999). « L'AMI, Constitution pour une économie globalisée », In M. Freitag & É. Pineault (dir.), Le monde enchaîné,. Montréal, Éditions Nota Bene, p. 35-93. POPKEWITZ, T.S. (1998). « Knowledge, power, and curriculum : Revising a TRSE argument », Theory and Research in Social Education, nº 26, p. 83-101. PRICE, D. J. de Solla. (1963). Little science, big science, New York, Columbia University Press. RAMONET, I. (2000). « L'aurore », Le Monde Diplomatique, nº 550, janvier, p. 1. RENÉ, É. & GUILBERT, L. (1994). « Les représentations du concept de microbe : un construit social incontournable ? », DIDASKALIA, nº 3, p. 43-60. RESTIVO, S. (1988). Modern science as a social problem, Social Problems, vol. 35, nº 3, p. 206-225. ROCHEX, J-Y. (1995). Le sens de l'expérience scolaire, Paris, Presses universitaires de France RORTY, R. (1993). Conséquences du pragmatisme, Paris, Seuil. SASSOWER, R. (1997). Technoscientific angst : Ethics and responsibility, Minneapolis, University of Minnesota Press. SIMONNEAUX, L. (2000). « A study of pupils' conceptions and reasoning in connection with « microbes », as a contribution to research in biotechnology education », International Journal of Science Education, vol. 22, nº 6, p. 619-644. TESTART, J. (1998). « Espèces transgéniques : ouvrir la boîte de Pandore ? », Manière de Voir, nº 38, p. 15-17. The New London Group. (1996). « A pedagogy of multiliteracies : Designing social futures », Harvard Educational Review, nº 66, p. 60-92. VIVERET, P. (2000). « Pour redonner sa noblesse à l'action politique », Le Monde Diplomatique (supplément), nº 554, mai, p. I et III. WALLACH, L. (1998). « La déclaration universelle des droits du capital », Manière de Voir, nº 42, p. 50-52. WEISS, R. (1997). « A suitable treatment », Nature, nº 389, p. 144-145. WYNNE, B. (1996). « May the sheep safely graze ? A reflexive view of the expert-lay knowledge divide », In S. LASH, B. SZERSZYNSKI & B. WYNNE (Eds), Risk, environment and modernity : Towards a new ecology, London, Sage, p. 44-83. 1. Selon Bourque, Duchastel & Pineault (1999), la citoyenneté corporative « produit la soumission de la régulation politique à la régulation technojuridique et celle de l'État démocratique à l'État de droit. Formée des acteurs corporatifs dans le champ des pratiques économiques et des individus incorporés dans des groupes de proximité au sein de l'espace culturel [ethnie, langue, appartenance sexuelle, etc.], la citoyenneté corporative interpelle le tribunal plutôt que le parlement » (p. 61). L'arbitrage des conflits dans le cadre de l'ALENA témoigne de ce renversement des rapports entre le législatif et le technojuridique. Par ailleurs, le recours de plus en plus fréquent aux tribunaux pour obtenir des avis sur les droits fondamentaux constitue une indication de la progression de la judiciarisation des rapports sociaux. 2. Dans ce court essai, le concept de citoyenneté sera envisagé sous l'angle particulier de certaines des conditions nécessaires à la participation des individus et des groupes aux débats publics liés à la production et aux usages des technosciences. Il s'agit d'une dimension centrale du concept de citoyenneté, à tout le moins dans la perspective de Locke pour qui, selon Capitan (2000), la participation à la vie publique donnerait sa pleine mesure à la condition humaine. 3. Ce projet d'accord a été préparé sous les auspices de l'Organisation pour la Coopération et le Développement Économique (OCDE) et négocié plus ou moins en secret par les vingt-neuf pays les plus riches de la planète. Véritable charte des droits du capital et du nouveau « citoyen investisseur » selon l'expression utilisée par Wallach (1998), cet accord visait à accorder aux multinationales un ensemble de droits inaliénables ce qui, selon Pineault (1999), « aurait provoqué un renversement complet du rapport institué pendant la modernité entre la souveraineté politique des États et la puissance organisationnelle des acteurs économiques " privés " » (p. 34). Autrement dit, la souveraineté des États aurait été réduite à la portion congrue et subordonnée à celle d'un nouvel ordre économique mondial. 4. Les différents groupes qui ont participé aux événements de Seattle ne partageaient pas nécessairement les mêmes intérêts. On peut penser que leur alliance en vue de contrer les projets de l'OMC avait quelque chose de stratégique et qu'il sera donc nécessaire de poursuivre le dialogue en vue d'assurer la pérennité et la solidité du réseau. 5. Il est nécessaire de rappeler que cette coalition a été organisée pour protester contre le fait que le gouvernement a suspendu dans cette affaire les mécanismes habituels de la consultation publique en évoquant l'urgence de la situation consécutive à la célèbre tempête de verglas de l'hiver 1998. 6. Les anglophones utilisent l'éloquente expression « a god's eye view of the world » en référence à cette possibilité pour l'observateur de se situer en extériorité et de s'abstraire du monde auquel il participe. Cette expression est difficile à traduire, mais il est aisé de comprendre que l'adoption d'une telle position est le privilège de ceux et celles qui ont les mêmes attributs que Dieu. 7. Le réseau international des stations météorologiques constituent un exemple paradigmatique de cette possibilité. Il n'y a plus qu'une manière légitime de dire le temps. Les savoirs locaux et traditionnels perdent toute valeur au profit de ceux qui sont produits à l'intérieur de cet immense réseau. Or, il importe de se rappeler que l'hégémonie d'une forme particulière du savoir à une époque ne lui confère pas un caractère universel indépendant des contingences de sa production. 8. Selon Fourez Englebert-Lecompte et Mathy (1997), ce que l'on nomme l'universalité des savoirs scientifiques résulte d'un processus similaire à celui qui consiste à imposer la langue anglaise comme langue universelle. Voici comment ils articulent ce point de vue : « suite à de multiples rapports de force, résistances, négociations et impositions, cette langue est devenue le passage obligé (et imposé) pour ceux qui veulent participer à certains échanges. Ainsi en est-il des conceptualisations des sciences qui, peu à peu, éliminent d'autres connaissances au profit de celles que la communauté scientifique a standardisées » (p. 17). 9. Les « microbes » font désormais partie intégrante de notre sens commun et les enfants apprennent en bas âge que ces « bibites » adorent la saleté et transportent des maladies. C'est à tout le moins ce que révèlent nombre d'études (René & Guilbert, 1994 ; Simonneaux, 2000) qui par ailleurs montrent que ces conceptions élaborées dès la tendre enfance tendent à se perpétuer même chez ceux et celles qui ont fréquenté l'enseignement des sciences. La situation était fort différente à l'époque de Pasteur et ce n'est qu'au terme d'un long cheminement que les microbes ont acquis le droit d'être, c'est-à-dire de devenir des acteurs dont on tient compte dans la construction de la réalité sociale. 10. L'ethnologue Darré (1999) qui a étudié les interactions entre des paysans et des experts en milieu agricole français souligne ce qui suit à propos de leurs relations : « Et lorsque ces deux là [conseiller technique agricole et agriculteur] discutent de questions techniques, la dissymétrie des positions sociales passe par la valeur, sociale, attribuée à leurs façons respectives de connaître la réalité. Du point de vue de la connaissance, rien ne permet de décider que l'une ou l'autre est supérieure à l'autre - ou alors il faudrait disposer de l'étalon d'un point de vue de Dieu. S'il y a inégalité de valeur - et il y a - elle est sociale » (p. 136). 11. Ce scénario est inspiré d'une situation réelle, soit le contenu du journal télévisé du dimanche soir à Radio-Canada. Lors d'une des émissions l'animatrice Michèle Viroly recevait en entrevue le journaliste scientifique Jean-Pierre Rogel afin que ce dernier commente la nouvelle parue dans la revue Nature à propos du séquençage du chromosome vingt-deux. Le discours du journaliste à cette occasion ressemblait davantage au discours du journaliste A qu'à celui du journaliste B. Cela ne signifie pas que Jean-Pierre Rogel aurait pu dans d'autres circonstances produire un autre discours, mais la forme que revêt le bulletin de nouvelles n'est guère propice à la formulation de positions nuancées. | |||||||||||||||||||||||||||||||


 | 
Rapport aux savoirs technoscientifiques et citoyenneté : un point de vue  |